Opzoeken
825 - 840 van 3118 nieuws bekijken
-
Renforcement de la justice au Burkina Faso : capitalisation des résultats du Projet PARJI
Abel YAMEOGO | 11/06/2024
Le Projet d’Appui au Renforcement de la Justice pour lutter contre l’Impunité (PARJI), financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Enabel au Burkina Faso a organisé les 21 et 22 mai 2024 à Ouagadougou, un atelier de réflexion, d’analyse des informations et de finalisation des fiches de capitalisation, avec les acteurs du processus de capitalisation, de certains résultats de ses interventions sur le terrain. En effet, tout au long du processus de mise en œuvre du PARJI, de nombreuses expériences prometteuses ont été identifiées et Enabel a souhaité capitaliser sur certaines d’entre elles en vue de renforcer son apprentissage à partir des approches et outils développés ainsi que des résultats atteints et en cours d’atteinte.En sessions plénières et en groupes de travail, les participant·es à l’atelier ont apporté des contributions, diversifiées et pertinentes pour la consolidation de l’exercice de capitalisation qui porte sur quatre thèmes que sont : les cadres de concertations des acteurs de la chaîne pénale comme outil efficace de communication entre acteurs de la chaîne pénale au niveau local ;le désengorgement des juridictions à travers les audiences correctionnelles extraordinaires ;le renforcement des capacités d’interprétation judiciaire par l’institutionnalisation de la filière Interprétation judiciaire au sein de l’ENAM et le renforcement des capacités des chefs de juridiction en tant qu’outil pour une meilleure efficacité de la chaîne pénale.Finalisation des drafts de fiches de capitalisation et recueil de témoignages Ces deux jours de travaux ont connu la forte implication des acteurs du processus de capitalisation. Cela a permis de finaliser et valider, les drafts des fiches de capitalisation élaborés par le cabinet MASSAKA SAS, recruté pour travailler sur les thématiques et objets de capitalisation du PARJI.Au cours de l’atelier, des témoignages et autres données apportés par les participant·es ont été recueillis pour alimenter la production de capsule vidéo et bien d’autres produits de capitalisation du PARJI. L’accompagnement de l’Union européenne fortement apprécié A l’ouverture de l’atelier, le Country Program Manager d’Enabel au Burkina Faso M. François DESSAMBRE a remercié l’Union européenne pour avoir alloué les fonds indispensables à l’exécution du PARJI et pour avoir accordé sa confiance à Enabel, notamment en lui confiant la mise en œuvre de ce projet. Il a également traduit sa reconnaissance aux premières autorités du Ministère de la Justice et des Droits Humains, chargé des Relations avec les Institutions et l’ensemble de ses directions et services rattachés, pour l’accompagnement permanent et efficace des équipes d’Enabel, dans la mise en œuvre des activités visant à répondre aux besoins des justiciables.Par Kimsegninga SAVADOGO, Communication Assistant
-

Renforcement des compétences juridiques au Burkina Faso
Abel YAMEOGO | 11/06/2024
Le Projet d’Appui au Renforcement de la Justice pour lutter contre l’Impunité (PARJI) d’Enabel au Burkina Faso a organisé du 15 au 17 avril 2024 à Ouagadougou, un atelier de renforcement des capacités des différents acteurs juridictionnels devant interagir avec l’Agence Nationale de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis ou Confisqués (ANAGRASC), sur le régime juridique des saisies et confiscations en matière pénale. L’atelier de formation organisé sur le thème « régime juridique des saisies et confiscations en matière pénale », a regroupé une trentaine de participant·es dont des officiers de police judiciaire, des procureurs, des juges d’instruction, des conseillers et des agents de l’ANAGRASC, une structure créée en février 2023 et en phase d’opérationnalisation. L’ANAGRASC a pour mission principale d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice, au cours d’une procédure pénale, la gestion de tout bien, quelle que soit sa nature, saisi, confisqué ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire, à l’exception des biens régis par des textes spéciaux.L’efficacité de l’ANAGRASC dépend des connaissances des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ses activitésPour l’accomplissement de cette mission, l’ANAGRASC doit interagir avec de nombreux acteurs judiciaires et non judiciaires dont l’efficacité dépendra de leurs connaissances des saisies et confiscations autour desquelles se greffe leur interaction avec la structure nationale en charge de la gestion des avoirs saisis ou confisqués. D’où la nécessité d’organiser cet atelier pour outiller les acteurs de la chaîne pénale, sur le régime juridique des saisies et confiscations dans la procédure pénale burkinabè. L’atelier a permis aux agents de l’administration judiciaire d’avoir des connaissances sur le dispositif juridique et institutionnel en vigueur, relatif à la saisie et à la confiscation en matière pénale. Plus spécifiquement, il a permis aux participant·es :d’améliorer leurs connaissances sur les textes juridiques en vigueur, régissant la saisie et la confiscation en matière pénale et sur les acteurs et leur rôle dans le processus de saisie et de confiscation en matière pénale ; de dégager les interactions entre les différents services collaborateurs et l’ANAGRASC ;de mieux percevoir le rôle de l’ANAGRASC dans la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués.Pour la consolidation des connaissances des acteurs de la chaine judiciaire, un recueil de textes juridiques relatifs à la saisie et à la confiscation a aussi été mis à leur disposition.Un soutien indispensable de Enabel et de son partenaire, l’Union européenneL’atelier a été présidé par le Secrétaire Général du Ministère de la Justice et des Droits Humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, qui s’est réjoui de la tenue de cet atelier grâce à l’accompagnement de l’Union Européenne. Il a souligné que le besoin de l’ANAGRASC en ressources humaines ayant des compétences constamment mises à jour et à la hauteur des attentes est crucial car cette structure est nouvelle et fait ses premiers pas dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.En effet, le PARJI, mis en œuvre par Enabel sur financement de l’Union européenne, s’est engagé à accompagner le processus de l’opérationnalisation de l’ANAGRASC à travers un double appui matériel et technique. Cet accompagnement vise à permettre à l’ANAGRASC de mener à bien sa mission spécifique dont accomplissement est tributaire, entre autres, de l’action d’une diversité d’acteurs juridictionnels externes à cette structure.L’ANAGRASC assure essentiellement une mission de gestion des biens saisis et confisqués et n’a aucune compétence juridictionnelle pour saisir et confisquer lesdits biens. C’est donc dire que l’efficacité des autorités d’enquête et de poursuites pénales à travers l’identification et le dépistage des avoirs criminels ainsi que les biens de valeur équivalente en vue des saisies et confiscations est indispensable à l’efficience, la productivité de l’Agence. A travers l’atelier de formation, la direction générale, dans une dynamique de synergie d’actions, a voulu sensibiliser les autorités d’enquêtes et de poursuites pénales sur le régime juridique des saisies et confiscations qui conditionnent sa mission de gestion.Par Kimsegninga SAVADOGO, Communication Assistant
-

Restauration des terres au Burkina Faso : une avancée cruciale vers une agriculture durable
Abel YAMEOGO | 11/06/2024
Une équipe du Portefeuille Thématique Climat Sahel (PTCS) – Volet Burkina Faso a effectué une visite terrain des aménagements par les techniques de Conservation des Eaux et des Sols/Défense et Restauration des Sols (CES/DRS : Cordons pierreux, demi-lunes, zaï) dans les communes de Meguet, de Kando, de Koupela et d’Absouya du 20 au 24 mai 2024. L’objectif? S’enquérir de l’état d’avancement des travaux d’aménagement par les agro-pasteurs bénéficiaires du projet desdites communes. Au regard de la saison pluvieuse qui s’installe à grand pas dans ces localités, il était de bon ton de s’assurer que les agriculteurs ciblés pourront exploiter les superficies concernées par la restauration et la conservation au cours de cette saison humide 2024, dans le cadre du projet Rilgré dont la réalisation est assurée par le consortium Solidar Suisse et Béog nèré Agroécologie. Il était question pour l’équipe d’échanger directement avec les populations bénéficiaires dans le but de recueillir les difficultés qu’ils rencontrent, leurs appréciations, leurs préoccupations et leurs suggestions en vue d’améliorer au tant que possible la collaboration pour plus d’efficacité dans la réalisation des activités prévues. Dans certains villages, les cordons pierreux, les demi-lunes et le zaï sont pratiqués de façon combinée sur les mêmes superficies. Par contre, dans d’autres villages, l’absence des moellons a contraint les agriculteurs à ne pratiquer que les demi-lunes et le zaï. C’est le cas par exemple du village de Banka et d’autres villages environnants de la commune de Pouytenga.Dans toutes les communes visitées, les équipes du consortium Solidar Suisse –Béog nèré Agroécologie sont à pied d’œuvre pour accompagner les populations cibles à maitriser les techniques de restauration et à les pratiquer sur les terres dégradées afin de pouvoir améliorer leurs rendements agricoles dès la saison hivernale 2024. Pour cette année 2024, ce sont 375 hectares de terre dégradées qui sont en aménagement en cordon pierreux, demi-lune et Zaï. Cette superficie vient en complément aux 1150 hectares de terres déjà aménagées par la charrue Delifino. Le défi à relever au cours de cette campagne pluvieuse reste la végétalisation de ces terres aménagées qui contribuera également à leur restauration. En rappel, dans le cadre du PTCS volet Burkina Faso, financé par le Royaume de Belgique et mis en œuvre par Enabel, le consortium d’ONG Solidar Suisse –Béog nèré Agroécologie a obtenu un accompagnement financier pour la réalisation du projet Rilgré. Ce projet qui couvre 13 communes dans les régions du Plateau central, du Centre-Nord et du Centre-Est, envisage restaurer 2650 hectares de terres dégradées d’ici fin juin 2026 pour une meilleure production agro-pastorale des zones ciblées.
-
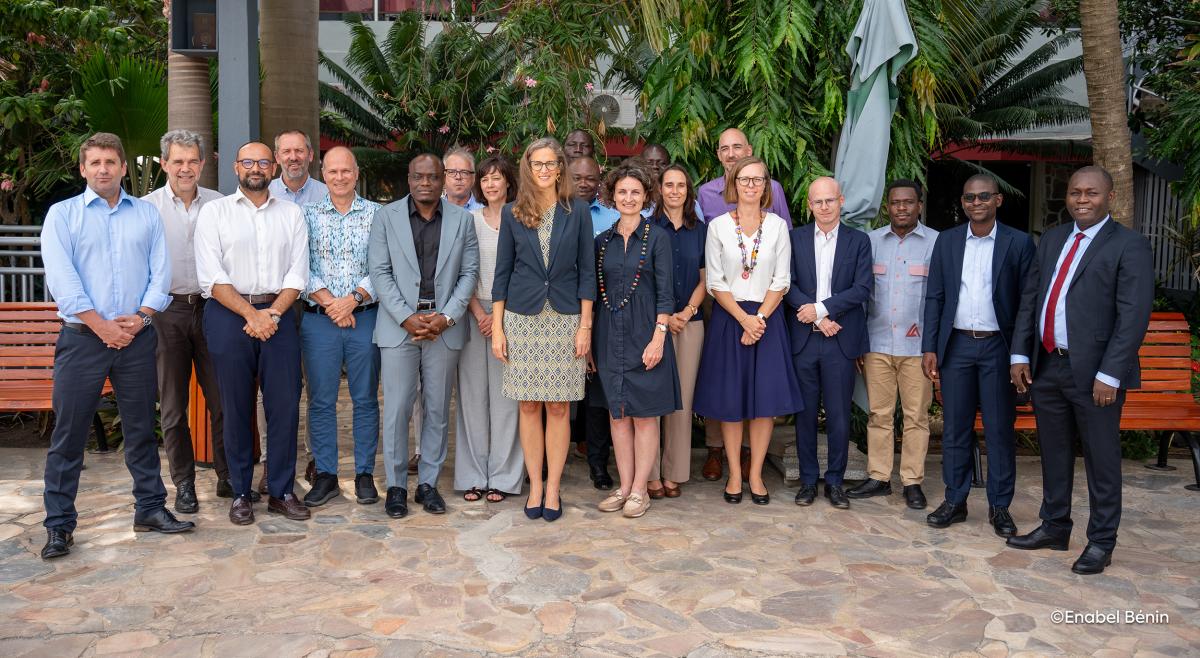
Enabel Bénin & Côte d’Ivoire : une approche stratégique régionale dans l’Arc de Stabilité élaborée
Reece-hermine ADANWENON | 07/06/2024
Du 28 au 29 mai 2024 à Cotonou s’est tenu un atelier qui a permis de définir les bases de l’approche stratégique régionale d’Enabel dans l’Arc de Stabilité.Son objectif ? Développer des dynamiques transversales dans cette région où Enabel a déjà une légitimité et une crédibilité reconnues grâce à ses actions au Bénin et en Côte d’Ivoire.Durant deux jours, les partenaires nationaux, à savoir la Direction Générale du Financement du Développement du Bénin et la Primature de la Côte d’Ivoire, les Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) à savoir l’Union européenne et les acteurs de la team Belgium, notamment les Ambassadeurs de la Belgique au Bénin et en Côte d’Ivoire et en appui les équipes Enabel Bruxelles, du Bénin et de la Côte d’Ivoire ont contribué ensemble à la cocréation de cette dynamique. Au terme des échanges constructifs, plusieurs résultats en découlent : - Le contexte spécifique pour chaque pays est exploré et les visions et politiques nationales partagées; - Une approche globale est définie par la Team Belgium avec un focus Enabel et Belgique dans les pays et la sous-région ; - Un cadre sur la vision Bénin & Côte d'Ivoire et approche sous-régionale et la structuration du plan d’actions : programmatiques, port, corridors, secteur privé, et des actions de prospection au Togo sont élaborées.
-

Le quart de siècle d’Enabel célébré au Bénin sous le signe du partage et de l’innovation
Reece-hermine ADANWENON | 05/06/2024
Les 30 et 31 mai 2024, le Palais des Congrès de Cotonou a accueilli la première édition de la Foire aux Savoirs, un événement organisé par Enabel au Bénin.Cette foire a rassemblé plus de 1200 participants venus des différentes régions du pays, unissant experts, partenaires, autorités et entrepreneurs pour célébrer les 25 ans d’Enabel, avec un focus sur le partage des savoirs, des bonnes pratiques, et la capitalisation des expériences et impacts des projets et programmes mis en œuvre conjointement avec les partenaires nationaux.Des discussions enrichissantes et pertinentesAu cœur de la Foire aux Savoirs, 35 intervenants de renommée nationale et internationale ont partagé leur expertise au cours de six panels de discussion. Les thématiques abordées incluaient : la santé, l’agriculture, la sécurité, le secteur portuaire, l’innovation et l’entrepreneuriat. Ces panels ont permis d'explorer des problématiques cruciales et de proposer des solutions adaptées aux besoins du Bénin, renforçant ainsi la collaboration entre les différents acteurs du développement.Un événement riche en interactions et opportunitésLa Foire aux Savoirs a été l’occasion idéale pour nos experts et participants de nouer des contacts précieux. Les discussions ont non seulement mis en lumière des perspectives nouvelles, mais elles ont également permis de renforcer les synergies entre les partenaires nationaux, les acteurs du secteur privé et les représentants des organisations internationales.Célébration de l’art et de la cultureL’événement a également mis en avant l’importance de l’art et de la culture dans le développement socio-économique. Un espace dédié aux expositions artistiques et culturelles a permis aux participants de découvrir la richesse culturelle béninoise. Un Live-painting est également organisé sur le thème de la troisième édition du prix Awa « les industries culturelles et créatives ». L’artiste peintre Typam a remporté le premier prix, Jeannette Legue, plasticienne, 2ème prix et Isaac Vitou, artiste peintre-designer et plasticien, le 3ème prix. Le concert de clôture de la foire, animé par des artistes locaux, a célébré en beauté les 25 ans d’Enabel au Bénin, créant un moment de partage et de fête pour tous les présents.Au Bénin, Enabel reste déterminée à poursuivre son engagement pour le développement durable, en collaboration étroite avec tous ses partenaires.
-

A call for sustainable tourism at Uganda’s Pearl of Africa Tourism Expo
John CANDIGA | 04/06/2024
The Pearl of Africa Tourism Expo (POATE) has continued to bring together hosted buyers, media, local suppliers of tourism products, and trade visitors in one place through face-to-face meetings that translate into long-term business relationships. This year’s event was celebrated under the theme; “Sustainable Tourism”. The event brought together tourism consumers and travel trade buyers to the heart of Kampala, Uganda to create business networking opportunities, education sessions, and inclusion of Uganda in the African specialist tour operators’ itineraries to increase Uganda’s destination awareness and recognition.In a speech delivered by the Vice President, Jessica Alupo, during the opening ceremony, President Yoweri Museveni said that the government has prioritized tourism as a formidable growth sector of the economy, as exhibited in the past three National Development Plans. He said the country’s youthful population should be used to the advantage of the sector, especially in providing a vibrant labour force to the industry. “There is no doubt that the most sustainable way for tourism to create a lasting impact is by ensuring higher economic growth. With an increasingly larger proportion of the population participating in this growth at the Parish Development Model, tourism should be anchored so that there is equity and inclusion at this lower level,” he explained. The president rallied the tourism sector managers to carefully listen to the investors and travelers to identify their concerns for better marketing of Uganda as a better tourism destination.The CEO of the Uganda Tourism Board (UTB), Lilly Ajarova, said that the board is considering aggressive marketing of destination Uganda to new places, using all available marketing avenues. “We plan to expand our reach further through brand promotional campaigns, digital and mainstream media advertising, influencer marketing, and expo participation. We want to tell the story of our natural heritage, our past, our present, and write the stories of our future,” said Lilly.The Honorable Minister of State for Finance and Planning, Amos Lugolobi said that their role as government is to focus on the mobilization of resources for development through collaboration and by working together with stakeholders to address challenges and seize opportunities for sustainable progress in Uganda’s tourism sector. During a panel discussion on the impact of artificial intelligence on travel and tourism, the Vice Chancellor of Victoria University, Dr. Lawrence Muganga said that Uganda can become a global content creator, producing stunning virtual game parks, historical sites, and cultural events for platforms that support Virtual Realty, and even Netflix. This he said opens up a whole new revenue stream, allowing people worldwide to ‘visit’ Uganda from their living rooms, and sparking interest in experiencing the real attractions.“Embracing these innovative approaches can create a vibrant and sustainable tourism sector that offers unforgettable tourism experiences for visitors while driving sustainable economic growth and development”, said Dr. Lawrence Muganga.The Enabel Social Protection and Decent Work Project manager, Lucie Carlier in her speech during the closing ceremony said that the journey of promoting sustainable tourism in Uganda has been been one of coalition, collaboration and ambition to transform Uganda as a number one tourism destination in the whole world. “We firmly believe that sustainable tourism is not merely about attracting visitors; it is about fostering meaningful connections between travelers and the communities they visit”, said Lucie.As part of this year's Pearl of Africa Tourism Expo, the Uganda Tourism Board, and Enabel recognised 10 “Early Adopters” of the Fair Trade Tourism Certification Uganda. These were;I. Miika Eco Resort,ii. Karamoja Safari Camp,iii. Timu Eco Camp,iv. Morungole Eco Camp,v. Acholi Culinary Experience,vi. Acholi Homestay,vii. Turaco Treetops,viii. Ruhija Community Rest Camp,ix. Bushpig Backpackers, andx. Muhabura Cultural Experience and Craft Centre.The Sustainability and Fair Trade Tourism recognition, by the Uganda Tourism Board and Enabel, goes a long way in promoting Uganda as a sustainable tourism destination, an emerging tourism trend. More tourism and hospitality operators can continue to register for certification through the Fair Trade Tourism website www.fairtradetourism.org.The Pearl of Africa Tourism Expo (POATE) is an annual tourism and travel trade show organised by the Uganda Tourism Board. Each year, the expo brings together tourism value chain actors and stakeholders under the business-to-business and business-to-consumer formats, for networking opportunities, and business deals.The eighth POATE event was held at Speke Resort and Convention Centre in Munyonyo, Kampala from 23rd to 25th May 2024. The three-day expo brought together 70 hosted buyers, 240 exhibitors, over 5,000 trade visitors, and consumers in the heart of Kampala.
-
In Kigali, second National Agroforestry Conference promotes sustainable farming practices
Denise NSANGA | 01/06/2024
The Second National Agroforestry Conference has been successfully held in Kigali from 28 to 29 May 2024. The event emphasized the importance of adopting agroforestry practices among Rwandan farmers and policymakers to enhance soil protection, increase crop yields, diversify the sources of income, while restoring and sustaining the biodiversity to build a better resilience to climate change.Funded by the Smart Innovation through Research in Agriculture (DeSIRA) project, the two-day conference was organized by the Ministry of Environment in collaboration with the European Union, International Union for Conservation of Nature (IUCN), the Belgian development agency (Enabel), the International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF), the University of Rwanda (UR), KU Leuven and Ghent University.Rwanda’s government policies, including the National Strategy for Transformation (NST), the Green Growth Strategy, and the Forestry and Agriculture Sector Strategic Plan, aim to integrate agroforestry targets and promote practices that address the needs and knowledge of farmers. In her opening statement, the Minister of Environment, Dr. Jeanne d’Arc Mujawamariya, highlighted Rwanda's leadership in climate change initiatives. She noted that the adoption of agroforestry practices "stands as a beacon of hope, offering practical solutions that harmonize the needs of people and prosperity."Representatives from the Ministry of Agriculture and Animal Resources (MINAGRI/RAB) and the Ministry of Environment / Rwanda Forestry Authority (MoE/RFA) expressed their commitment to jointly enforce and coordinate agroforestry efforts in collaboration with key actors.The conference provided an opportunity to share key results from research and lessons learned from projects and proposed key technical solutions and recommendations. Among them, the setting of a national high-level agroforestry steering platform has been proposed, to better coordinate actors ensuring synergy and complementarity, to harmonize approaches and best practices, and to better involve and support farmers in the intensive adoption of agroforestry on their lands. 170 individuals, including representatives from central and local government, government-affiliated entities, NGOs, farmers’ associations, research institutions, the private sector, and various development partners participated in this conference.
-

In Tanzania, Enabel and partner VETA Mpanda train local tailors in beekeeping suit production
Deogratius KIMENA | 01/06/2024
In an effort to improve access to beekeeping inputs, Enabel and Vocational Education and Training Authority (VETA) Mpanda are facilitated bee suit making training to 15 local tailors from Nsimbo, Mlele, and Tanganyika districts from May 20th to June 1st, 2024. In addition to the technical skills, the trainees benefited with entrepreneurship skills.On picture, you can see skilled tailors wearing beekeeping suits they made after during their training.
-
Empowering honey sellers in Tanzania: Ikungi-Singida vendors gain skills in hygiene, packaging, and business
Deogratius KIMENA | 01/06/2024
A roadside honey seller from Ikungi-Singida gears up with practical learning on best hygienic practices, packaging, record-keeping, and business skills.Sessions were facilitated in collaboration with Small Industries Development Organization (SIDO) Singida for roadside honey sellers from Ikungi, Itigi, and Uyui districts from May 30th to June 1st, 2024.
-
Burkina Faso : Visite des ouvrages réalisés dans le cadre de l'accès à l’eau potable
Abel YAMEOGO | 31/05/2024
Le Directeur Pays visite les réalisations dans la ville de FadaLe vendredi 26 mai 2024, Danny Dennolf, Directeur pays d’Enabel au Burkina Faso a effectué une visite terrain dans la ville de Fada. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’Enabel, Accès à l’eau potable et à l’assainissement, dans la localité. Accompagnés de quelques collaborateurs*trice, le Directeur Pays a visité les infrastructures réalisées par Enabel à travers le Projet d'Appui aux Droits à l'Accès à l'Eau Potable et à l'Assainissement de la ville de Fada N'Gourma(#PADAEPA) dans la province du Gourma, région de l’Est du Burkina Faso. Ce projet a été financé par le Royaume de Belgique à hauteur de 11 600 000 € (7 609 101 200 FCFA) avec une contrepartie de l’Etat Burkinabè qui s’élève 257 115€ (168 656 384 FCFA), soit un budget total de 11 857 115€ (7 777 757 584 FCFA). Les ouvrages réalisés visent l’amélioration du taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de la population de Fada et se composent de : Une (1) réhabilitation de l’ouvrage de prise ; Une (1) nouvelle station de traitement d’eau de 200m3/h ; Un (1) réservoir de stockage de 500m3 en béton armé ; Un (1) château d’eau de 500m3 en béton armé ; Deux (2) châteaux d’eau réhabilités respectivement de 300 m3 et de 150 m3 ; Vingt-six (26) km de réseau de distribution dans la ville ; Dix-sept (17) bonnes fontaines ; et Trois cent quatorze (314) latrines réalisées dans vingt un (21) écoles et dont la remise officielle a été faite à la Commune de Fada N’Gourma avec la participation de l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) lors de la visite.Ces actions du projet PADAEPA qui est maintenant clôturé, se poursuivront avec le nouveau portefeuille bilatéral et consisteront principalement à :Renforcer les réseaux de distributions dans la ville ;Mettre en place des bornes d’incendie ;Fournir des kites de branchement privé à l’ONEA.Outre son passage sur les différents sites des ouvrages réalisés, il a effectué des visites de courtoisies à des partenaires et acteurs clés de la localité. Il s’est rendu avec sa délégation au Gouvernorat de la région de l’Est, puis à la mairie de la commune de Fada où il a été reçu respectivement par M. Siaka Ouattara, Secrétaire Générale du gouvernorat et M. Abdoul Kabir Maiga, Secrétaire Générale de la délégation spéciale de la commune. Il n’a pas aussi manqué de saluer au passage les responsables coutumiers, acteurs importants dans la gouvernance locale et dans la mise œuvre globale du projet.Cette visite a permis au Directeur Pays de constater les réalisations sur le terrain, et de toucher du doigt les enjeux liés à la mise en œuvre des activités dans cette localité très affectée par la crise sécuritaire.
-
Mieux soigner en RDC : du matériel pour sauver des vies
Paola VANGU TSAKALA | 31/05/2024
Dans le cadre de l'amélioration de l'encadrement et de la supervision des aires de santé, ainsi que de l'approvisionnement en intrants, Enabel, par son intervention en santé et protection sociale à Kinshasa, a procédé à la remise d'un véhicule 4x4 et deux motos au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en faveur de la zone de santé de Limete.La cérémonie de remise du matériel a eu lieu au bureau de la Division Provinciale de la Santé à Kinshasa, en présence du Ministre Provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que de la Coordinatrice des projets d'Enabel à Kinshasa. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour améliorer la qualité des soins de santé et assurer une couverture santé universelle.Le matériel mis à disposition permettra de renforcer la présence de l'équipe cadre de la zone de santé de Limete et dans les aires de santé. En outre, cela facilitera un coaching rapproché et garantira la disponibilité permanente des intrants requis pour offrir des soins de qualité. Ce matériel roulant jouera un rôle crucial dans les supervisions régulières et l'acheminement des intrants essentiels jusqu'aux centres de santé les plus éloignés.Cette action s'inscrit dans une démarche globale visant à renforcer le système de santé à Kinshasa et à répondre aux besoins spécifiques des zones de santé locales. Enabel, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, réaffirme ainsi son engagement à améliorer les conditions de santé et à promouvoir l'accès aux soins pour tous.La Zone de Santé de Limete, avec ce nouvel équipement, sera mieux équipée pour assurer un suivi efficace et une distribution régulière des intrants médicaux, contribuant ainsi à l'amélioration des services de santé offerts à la population. Cette initiative témoigne de la volonté des partenaires de développement et des autorités sanitaires de garantir une prise en charge médicale de qualité et accessible.
-

Le Burundi célèbre l'excellence des jeunes talents avec la première édition du concours « Umwuga Award »
Donavine KWIZERA | 29/05/2024
C'est fantastique de voir le Burundi mettre en avant les jeunes talents à travers la première édition du concours "Umwuga Award" ! Cette compétition nationale des métiers offre une plateforme unique aux jeunes passionnés de moins de 25 ans qui ont suivi une formation technique et professionnelle. Avec 1500 inscriptions et 46 finalistes sélectionnés après des présélections rigoureuses, l'engagement et la détermination de ces jeunes talents sont véritablement inspirants. Après trois mois d'entraînement intense, la finale qui s'est déroulée en octobre 2023 a été un véritable moment de célébration et de reconnaissance pour ces jeunes artisans. Sur les 46 finalistes, 24 jeunes ont gravi les marches du podium, recevant ainsi une reconnaissance bien méritée pour leur excellence dans l’un des huit métiers en compétition. L'initiative, portée par le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique en collaboration avec la Chambre Fédérale de Commerce et de l'Industrie et Enabel, l’agence belge de développement, vise à stimuler l'intérêt des jeunes pour les métiers et à promouvoir l'excellence dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Un pas important vers la valorisation des compétences artisanales et techniques au Burundi, et cela ouvre la voie à un avenir prometteur pour la jeunesse du pays.Bravo aux lauréats et à tous les participants pour leur passion et leur engagement exceptionnels!
-

Mobilisation à Isangi, RDC: Le Procureur place le dialogue sur les violences sexuelles au cœur du débat public
Doudou-bienvenu KAJANGU | 28/05/2024
Philémon Lombe Yombo, Procureur de la République et chef de parquet auprès du Tribunal de paix d’Isangi dans la Tshopo, a échangé avec la population d’Isangi-Centre sur les questions juridiques dans le cadre de la lutte contre l’impunité en matière de violences sexuelles. E ce, au cours d’une sensibilisation de masse initiée par des acteurs bénévoles impliqués dans la prévention des VBG. Près de 200 personnes sont venues écouter, poser des questions et obtenir des réponses auprès des acteurs engagés dans le processus de prise en charge complète des victimes de violences sexuelles à Isangi : le corps médical de l’hôpital Général de référence, le Responsable local de la Police, des affaires sociales et le Procureur de la République nouvellement affecté à Isangi. Après un tour de table où chaque acteur a expliqué sa mission dans la prise en charge des victimes avec l’appui du Programme de Lutte contre les Violences Sexuelles (PLVS) d’Enabel, la population a eu le privilège de prendre la parole et poser directement des questions permettant un dialogue ouvert et franc avec tous les intervenants. Le Procureur s’est rapidement retrouvé au centre du débat face à un public dénonçant l’impunité et le laxisme de la justice sur des cas de violences sexuelles et curieuse de connaitre les dispositions et l’interprétation des lois qui condamnent ces actes. Toutes les questions ont été abordées allant du consentement ou non des mineures au comportement sexuel transgressif et autres formes d’harcèlement sexuel et du viol auxquelles l’autorité judiciaire a donné des éclaircissements tout en mettant en garde les potentiels agresseurs, à la grande satisfaction de la population. A l’issue de cet échange, des recommandations ont été formulées au Procureur et aux organisateurs. La population d’Isangi a encouragé la justice à réprimer sans atermoiements tout acte de viol. Elle a également suggéré que le même débat public se fasse avec les populations des autres secteurs et chefferies du Territoire d’Isangi. Pour Perez BOLENGELAKA, acteur de la société civile et Président du GAP (Groupe d’Acteurs bénévoles impliqués dans la prévention des VBG) « la population est encore ignorante des textes de lois réprimant les actes de violences sexuelles, ce qui laisse souvent les victimes abusées à souhait et les agresseurs de plus en plus récidivistes ». Le contexte de ce débat public a souligné l'importance cruciale de lutter contre l'impunité liée aux violences sexuelles à Isangi en promouvant la dénonciation des cas de viols, le référencement des victimes dans le délai vers les centres pour une prise en charge complète et gratuite et susciter un changement social sur les questions de violences sexuelles. Cette première rencontre entre le Procureur et les habitants d’Isangi a été aussi marquée par une production théâtrale édifiante sur le thème de la dénonciation des arrangements à l’amiable en matière de violences sexuelles. Ce qui devrait largement contribuer à décourager les familles des victimes et des agresseurs qui s’adonnent à cette pratique.
-
Projet Climat - Sahel: lancement des plateformes d'innovation à Koupéla au Burkina Faso
Abel YAMEOGO | 24/05/2024
Le volet régional du Portefeuille Thématique Climat Sahel (PTCS) à organisé du 5 au 11 mai 2024 un atelier préparatoire et de lancement des activités de mise à l’échelle des plateformes d’innovation dans la commune de Koupéla. Cet atelier dont les travaux ont été lancé par Mme Alice BÉLEMVIRÉ/NIKIÈMA, présidente de la délégation spéciale de la commune de Koupéla, a connu la participation de plusieurs acteurs clés, actifs dans la commune en matière de résilience aux changements climatiques et de gestion durable des écosystèmes, pour une planification concertée et participative des activités. En mai 2023, un atelier préparatoire pour de la mise à l'échelle des plateformes d'innovations, avait été réalisé à Tenkodogo et a occasionné la relocalisation de la zone pilote de l’implémentation de ces plateformes dans la commune de Koupéla. A la suite de ces travaux, le Portefeuille Thématique Climat Sahel (PTCS), un programme régional financé par la Royaume de Belgique et mis en œuvre Enabel, a rassemblé une fois de plus les parties prenantes pour créer un cadre d’échange afin de favoriser une synergie d’action et une collaboration entre les acteurs et les initiatives déjà en cours pour la mise à l’échelle des plateformes d’innovations. La mise en place de ces plateformes vise le renforcement de la résilience aux changements climatiques et la gestion durable des écosystèmes sahéliens. A travers un soutien au dispositif piloté par les acteurs de la recherche au Burkina-Faso, Mali, Niger et Sénégal, le PTCS entend favoriser le déploiement de ces dispositifs de proximité afin de mettre à la disposition des communautés locales les innovations existantes.Durant trois jours, les participants issus d’institutions de recherche, d’ONG, d’organisations et associations paysannes et des collectivités territoriales ont pu, grâce aux échanges et aux travaux de groupe :Identifier les objectifs prioritaires de la commune de Koupéla en matière de résilience aux changements climatiques et de gestion durable des écosystèmes ; Cartographier les parties prenantes pour chacun des objectifs prioritaires ;Avoir un aperçu des activités des acteurs, réalisées ou en cours de réalisation en lien avec les objectifs prioritaires dans la commune de Koupéla ;Identifier et prioriser les actions concrètes à mettre en échelle ; Identifier les points de synergie et de collaboration avec les acteurs présents dans les sites pilotes. A l’issue de cette session, l’équipe de programme PTCS grâce les données recueillies va œuvrer pour mettre en œuvre une stratégie d’implémentation des plateformes d’innovation à travers l’élaboration d’une feuille de route des activités et le recrutement non seulement de prestataire pour la mise à l’échelle des bonnes pratiques, mais aussi d’étudiants pour appuis à l’amélioration des technologies.
-

Enabel celebates 40 years of collaboration with Tanzania
Proscovia GREGORY | 23/05/2024
On May 16, 2024, Enabel's office in Dar es Salaam buzzed with excitement as we celebrated three monumental milestones: 40 years of bilateral cooperation between Tanzania and Belgium, 25 years of Enabel's impactful presence in Tanzania, and the inauguration of the new Representation office in Dar es Salaam. This event marked not only our enduring partnership but also underscored our shared commitment to driving sustainable development and improving livelihoods across the country.The event started with a warm welcome from Enabel’s Country Director, Koenraad Goekint, who highlighted the significance of the occasion and Belgium’s enduring partnership with Tanzania. Following this, His Excellency Peter Huyghebaert, Belgian Ambassador to Tanzania, reaffirmed Belgium's unwavering commitment to supporting Tanzania's development priorities, emphasizing that Belgium’s cooperation programs aim to address socio-economic inequalities, climate change, and urbanization. Belgium and Tanzania established diplomatic relations four decades ago, focusing on shared challenges and opportunities for mutual growth. Ambassador Huyghebaert recounted key areas of cooperation over the years, including transport, health, education, water and sanitation, agriculture, natural resource management, and public finance management. He particularly noted Belgium's significant role in revamping Tanzania's rail network in the 1980s and supporting the port sector from the onset of bilateral relations.For a quarter of a century, Enabel has been deeply involved in Tanzania, addressing critical issues and promoting sustainable development across the country. Our initiatives have spanned various sectors, including natural resources management, local governance, value chain development, and infrastructure enhancement. Our commitment to value chain development has played a pivotal role in driving economic growth and improving livelihoods in the country. Through targeted interventions, we have supported farmers and entrepreneurs to enhance productivity, access markets, and increase their incomes. During his address, Koenraad Goekint emphasized Enabel’s dedication to creating gender-balanced environments for youth and entrepreneurs through collaboration with stakeholders for vocational training and entrepreneurship opportunities. He highlighted the launch of a new five-year bilateral program aimed at empowering young people, particularly girls, in Kigoma through education and skills development. Furthermore, he touched on projects like the Water and Sanitation Kigoma Region Project (WASKIRP) and the Sustainable Agriculture Kigoma Regional Project (SAKIRP), which have significantly transformed communities by improving access to clean water and sanitation and strengthening agricultural value chains.Ambassador John Ulanga, Director of International Trade and Economic Diplomacy at the Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation expressed gratitude for Enabel's efforts to support the country towards sustainable and inclusive development. He emphasized the importance of maintaining bilateral ties to utilize opportunities in various areas, including investment and trade, to further promote development.As part of our achievements over the past decades, we showcased a new chapter in Enabel's journey—the opening of our vibrant and dynamic office space in Dar es Salaam where we collaborated with local artists to create a living exhibition within the walls of Enabel. This new space symbolizes our unwavering commitment to Tanzania and our determination to continue making a positive impact in the years to come. With our collaborative atmosphere, this space serves as a hub for innovation, creativity, and partnership.In closing, Koenraad Goekint extended a warm invitation to all attendees to explore our new space, engage in enriching discussions, and cultivate new connections that will drive our collective mission forward. "To my esteemed colleagues, I envision this office as a sanctuary of inspiration and empowerment, where ideas blossom and aspirations soar. Karibuni sana, Ahsanteni," he concluded.






